
Les premiers cantonnements de la Légion sont implantés à Langres, Bar-le-Duc, Agen et Auxerre. Les anciens des gardes suisses et du régiment Hohenlohe sont placés dans le 1er bataillon. Les 2e et 3e reçoivent les Suisses et les Allemands, le 4e est réservé aux Espagnols et Portugais, le 5e aux Sardes et Italiens, le 6e aux Belges et Hollandais et le 7e aux Polonais.
Au commencement, la Légion constitue un moyen très efficace pour retirer les éléments les plus « indésirables » de la société française du XIXe siècle. Ses rangs sont remplis de meurtriers, d'évadés, de mendiants, de criminels de droit commun et d'immigrés non désirés.
Le légionnaire est très mal formé, peu ou pas payé, et reçoit le plus sommaire en matière d'équipement, de vêtements et de nourriture. La motivation des hommes est alors au plus bas, car les raisons de rejoindre la Légion sont le plus souvent le désespoir et l'instinct de survie plutôt que le patriotisme. Certains légionnaires tentent très probablement d'échapper à de graves problèmes. Les conditions de vie et de travail sont terribles et les premières campagnes provoquent de lourdes pertes. En conséquence, les désertions posent un problème important à la Légion. Forger une force de combat efficace à partir d'un groupe de soldats peu motivés, représente une entreprise des plus difficiles. Dans ce but, la Légion développe d'emblée une discipline incroyablement stricte, dépassant de loin celle imposée à l'armée française régulière.
Les 8 000 légionnaires se répartissent dans plusieurs garnisons, en France, en Outre-mer et à DjiboutiLES RECRUES
Les recrues de la Légion proviennent désormais de pratiquement tous les pays du monde avec néanmoins une forte proportion de Slaves. Il n'en a pas toujours été ainsi et le recrutement des jeunes engagés volontaires varie avec les crises géopolitiques : Européens à la fin du XIXesiècle, Allemands à l'issue du second conflit mondial, Britanniques à l'issue des Malouines, Européens de l'Est dans les années 1990, etc.
Au fil des décennies , beaucoup de Légionnaires sont devenus, après leur vie militaire des personnalités dans le civil. Autant dans la politique comme Pierre Messmer, les affaires ou la culture comme Claude Nougaro, Ernst Jünger etc.
Bataille de Camerone
Légionnaire et officier | |
| Informations générales | |
| Date | 30 avril 1863 |
|---|---|
| Lieu | Camerone, à partir de 1927 Villa Tejeda, et aujourd'hui Camarón de Tejeda (1986) |
| Issue | Victoire mexicaine |
| Belligérants | |
| Commandants | |
| Capitaine Danjou, puis le sous-lieutenant Maudet, porte-drapeau, puis le sous-lieutenant Jean Vilain, payeur | Colonel Milan |
| Forces en présence | |
| 65 fantassins de la Légion étrangère | 1.200 fantassins 800 cavaliers |
| Pertes | |
| 31 morts, 34 survivants, dont de nombreux blessés | 300 morts, 300 blessés |
| Expédition du Mexique | |
| Batailles | |
En 1863, pendant l'expédition française au Mexique, l'armée française assiégait Puebla. Un convoi français partit du port de Veracruz le 29 avril 1863. Il était chargé de vivres, matériel de siège et de 3 millions en numéraire. Le colonel Jeanningros, commandant le Régiment Étranger, ayant eu des renseignements concernant l'attaque probable du convoi, décida d'envoyer la 3e compagnie explorer les abords de Palo Verde avant l'arrivée du convoi. Soixante-deux fantassins et trois officiers de la 3e compagnie du Régiment Étranger de la fameuse Légion étrangère furent donc envoyés à la rencontre du convoi, à l'aube du 30 avril.
Campagne précédant la bataille
La compagnie n'ayant pas d'officier disponible, ceux-ci étant atteints de la fièvre jaune, comme nombre de membres du corps expéditionnaire, le capitaine Jean Danjou, adjudant-major du régiment se porta volontaire pour la commander. Le sous-lieutenant Jean Vilain, payeur du régiment et le sous-lieutenant Clément Maudet, porte-drapeau, demandèrent à l'accompagner. Le colonel Milan, qui commandait 1.200 fantassins et 800 cavaliers mexicains, averti de leur passage, mit ses troupes en branle.
Déroulement
Partie de Chiquihuite vers une heure du matin, la compagnie passa devant le poste de Paso-del-Macho (Le Pas du mulet), commandé par le capitaine Saussier et poursuivit sa route. Après avoir dépassé le groupe de maisons appelé Camarón de Tejeda, elle arriva à Palo Verde vers sept heures du matin, après avoir parcouru en marche forcée les vingt-quatre kilomètres qui les séparaient de leur garnison de départ. Les légionnaires s'arrêtèrent pour faire le café.
C'est alors qu'ils repèrent les Mexicains. Le capitaine Danjou décide de se replier sur le village. À peine sont-ils arrivés sur les lieux qu'un coup de feu claque, blessant un légionnaire. La colonne dépasse alors le groupe de maisons. C'est à ce moment que les cavaliers du colonel Milan chargent la troupe qui est contrainte de former le carré. La première salve brise la charge et met en fuite les Mexicains.
Après avoir brisé une seconde charge de cavalerie, le capitaine Danjou et ses hommes se réfugient dans l'hacienda, espérant retarder au maximum la tentative de prise du convoi du colonel Milan. Malheureusement, au cours du repli, les deux mules qui transportaient les vivres et les munitions, effrayées par le bruit, échappent à leur contrôle et s'enfuient.
Une fois dans l'hacienda, les légionnaires s'empressent de barricader l'enceinte du mieux qu'ils le peuvent. Les Mexicains mettent pieds dans les pièces du rez-de-chaussée et interdisent, dès lors, l'accès à l'étage. Le sergent Morzycki est sur le toit du bâtiment principal pour observer les mouvements de l'ennemi.
Il est déjà dix heures du matin et les hommes du capitaine Danjou, qui n'ont rien mangé depuis la veille commencent à souffrir de la soif et de la chaleur. Un officier mexicain, le Capitaine Ramon Laisné somme les Français de se rendre, ce à quoi le capitaine Danjou fait répondre : "Nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas !". Il fait alors jurer à ses hommes de lutter jusqu'au bout.
Les Mexicains mettent le feu à l'hacienda mais n'osent pas donner l'assaut de manière frontale. Certains, depuis les chambres de l'étage tentent de pénétrer dans la pièce tenue par les légionnaires. Le capitaine Danjou est frappé d'une balle en plein cœur à la mi-journée et c'est au sous-lieutenant Jean Vilain que revient le commandement. Les Mexicains sont alors les seuls maîtres du corps de ferme.
Vers quatorze heures, c'est au tour du sous-lieutenant Jean Vilain de tomber, frappé en plein front. Le sous-lieutenant Maudet prend alors le commandement.
À 17 heures, autour du sous-lieutenant Maudet, il ne reste plus que douze hommes en état de combattre. C'est à ce moment-là que le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s’ils n’arrivent pas à abattre cette poignée de braves.
Neuf heures durant, les légionnaires vont affronter les troupes mexicaines sans boire, accablés par la chaleur des Hautes-Plaines, étouffés par la fumée des incendies. En fin d'après-midi, il ne reste en état de combattre que le sous-lieutenant Maudet, le caporal Maine, les légionnaires Catteau, Wensel et Constantin. Au signal de l'officier, ils déchargent leurs fusils et chargent à la baïonnette. Catteau meurt, criblé de balles en protégeant le sous-lieutenant de son corps ; celui-ci est lui-même blessé à deux reprises. Un officier mexicain somme les survivants de se rendre. Maine répond :
« Nous nous rendrons si vous nous faites la promesse la plus formelle de relever et de soigner notre sous-lieutenant et tous nos camarades atteints, comme lui, de blessures ; si vous nous promettez de nous laisser notre fourniment et nos armes. Enfin, nous nous rendrons, si vous vous engagez à dire à qui voudra l'entendre que, jusqu'au bout, nous avons fait notre devoir. »
« On ne refuse rien à des hommes comme vous » répondit le colonel mexicain Cambas.
Bilan
Les blessés furent transportés à l'hôpital de Jalapa où ils furent soignés. Les prisonniers furent ensuite échangés contre des prisonniers mexicains. Le premier échange eut lieu trois mois plus tard et permit à huit légionnaires d'être échangés contre deux cents Mexicains.
Le convoi français put cependant éviter l'attaque mexicaine et parvenir sans encombre à Puebla.
Par décision du 4 octobre 1863, le ministre de la guerre, Randon, ordonna que le nom de « Camerone » soit inscrit sur les drapeaux du régiment étranger. De plus, l'empereur Napoléon III décida que les noms de Danjou, Vilain et Maudet seraient gravés sur les murs des Invalides.
Un monument fut érigé sur le site du combat en 1892. Mais son abandon incita le colonel Penette, en 1948 à en dresser un nouveau, inauguré officiellement en 1963. C'est sur ce dernier que figure l'inscription :
Ils furent ici moins de soixante
Opposés à toute une armée.
Sa masse les écrasa.
La vie plutôt que le courage
Abandonna ces soldats Français
A Camerone le 30 Avril 1863
Aujourd'hui encore les militaires mexicains rendent hommage aux soldats mexicains et français tombés ce jour-là.




Main en bois du capitaine Danjou

Bataille de l'Alma
| Informations générales | |
| Date | 20 septembre 1854 |
|---|---|
| Lieu | Sur les rives de l'Alma |
| Issue | Victoire franco-britanno- turco-piémontaise |
| Belligérants | |
| Coalition britannique, turc, pièmontaise et française | Armée russe |
| Commandants | |
| Général de Saint Arnaud Lord Raglan | Alexandre Menchikov |
| Forces en présence | |
| Britanniques : 26 000 fantassins 1 000 cavaliers 60 canons Français : 28 000 fantassins 72 canons Turcs : 7 000 fantassins | 33 000 fantassins 3 400 cavaliers 120 canons |
| Pertes | |
| Britanniques : 2 002 morts France : 1 340 morts Total : 3 342 | 5 709 morts |
| Guerre de Crimée | |
| Batailles | |
| Sinop — Petropavlovsk — Alma — Balaklava — Inkerman — Sébastopol — Eupatoria — Taganrog — Chernaya — Kars — Malakoff | |
La bataille de l'Alma est une bataille qui opposa le 20 septembre 1854 une coalition franco-britanno-turco-piémontaise à l'armée russe lors de la guerre de Crimée sur les rives du fleuve l'Alma.
Préambule
Les coalisés ont débarqué leurs troupes le 14 septembre à Eupatoria. À Sébastopol, aussitôt informé, le prince-général Menchikov rassemble le maximum d'unités éparpillées en Crimée. Il décide de livrer bataille sur l'Alma, où ses troupes se trouveront en surplomb des forces adverses.
Menchikov aligne 40 000 hommes soit 42 bataillons et demi, 16 escadrons de cavalerie, 11 sotnias de cosaques et une centaine de pièces d'artillerie.
En face, les Britanniques tiennent le flanc gauche, les Français le centre et la droite. La flotte tient la côte.
Dans l'après-midi du 19, quelques accrochages ont lieu entre Russes et Britanniques, les Russes venant « tâter » la résistance adverse. Les troupes alliées ne sont cependant pas toutes rassemblées, et certaines unités britanniques arriveront encore dans la nuit.
La bataille
Si les Français sont en marche avant l'aube, les Britanniques prennent d'emblée du retard, contrariant le plan de bataille.
Les zouaves — 3e régiment de zouaves — de la division Bousquet accompliront la manœuvre décisive : escaladant la falaise avec le soutien des canons de la flotte, ils s'emparent de l'artillerie russe et la retournent contre les troupes de Menchikov. Se retrouvant alors en pointe, ils doivent résister aux vagues d'infanterie qui leur sont opposées en attendant les renforts.
Sous le feu russe, le reste de l'armée française peine et stoppe finalement vers le village de Bourliouk. L'artillerie du Général Canrobert arrive au pied de la falaise, mais les pentes sont trop raides et les canons ne peuvent monter en position renforcer les zouaves.
Sur le flanc gauche des Français, les Britanniques rattrapent leur retard, mais une erreur dans la manœuvre de Sir George Brown met à mal la formation de l'armée britannique. Espérant profiter de cette désorganisation, les Russes chargent mais sont repoussés par les fusiliers britanniques. Il s'ensuit une série d'échanges assez confus : Menchikov craignant que l'action des zouaves ne lui soit fatale, s'est déplacé avec son commandement face aux Français. De sa position excentrée, il peine alors à percevoir la situation face aux Britanniques et lance des contre-attaques contre des éléments de l'armée britannique. Croyant faire face à des divisions, l'infanterie russe se retrouve face à des bataillons et tirailleurs, avec le gros des Britanniques sur ses flancs. Malgré des ordres contradictoires, les commandants des unités britanniques ne laissent pas passer l'occasion et déciment leur adversaire.
À l'extrême flanc gauche du front britannique, trois bataillons, soit deux à trois mille hommes, font face à plus de 10 000 troupes russes, fraîches et n'ayant pas encore participé à la bataille. Les Britanniques, étirés en une fine ligne de deux rangs sur pratiquement deux kilomètres, avancent en faisant feu (une manœuvre difficile à l'époque). Dans la fumée et la confusion de la bataille, les Russes surestiment le nombre de troupes qui leur font face et se retirent.
Sur la droite, le général Canrobert parvient finalement à hisser ses canons en haut de la falaise. Les zouaves repartent et parviennent à percer et prendre le point culminant jusqu'alors occupé par l'état-major russe.
En retraite sur tout le front et sans réserves capables de s'opposer aux Franco-britanniques, la bataille s'achève en déroute pour l'armée russe.
Le général Paul-Frédéric Rollet (né 20 décembre 1875 à Auxonne - décédé le 16 avril 1941 à Paris) est un militaire français. Il est connu pour avoir été le premier inspecteur de la Légion étrangère.

Né à Auxonne, dans l’Yonne (France), où son père, ancien polytechnicien, servait comme officier au 46e régiment d'infanterie de ligne, il est admis à l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1894.
Après de brillantes études, il est affecté au 91e Régiment d'Infanterie à Mézières. Il rejoint ensuite le 1er Régiment Etranger à Sidi-Bel-Abbès (Algérie).
Il sert d’abord en Algérie (1899-1902) puis à Madagascar (1902-1905), avant de revenir en Algérie (1905-1909). Promu capitaine en mars 1909, il commande la 3e compagnie montée du 1er bataillon de marche du 2e REI de 1909 à 1914.
Mais la Première guerre mondiale éclate alors qu'il est en congé en France. Comme il veut absolument être au front, il se fait affecter au 31e Régiment d'Infanterie, puis au 331e Régiment d'Infanterie. Blessé deux fois, il est promu temporairement chef de bataillon, grâce à l'appui du général Gouraud. Après plusieurs victoires, il deviendra chef de bataillon à titre définitif.
Le 18 mai 1917, il retrouve la Légion étrangère et prend le commandement du Régiment de marche de la Légion étrangère (RMLE) comme lieutenant-colonel.
Sous son commandement, le régiment se couvrira de gloire lors des combats de Hangard-en-Santerre, de la Montagne de Paris, puis en perçant la ligne Hindenburg, combat qui deviendra la fête du 3e REI, régiment héritier des traditions du RMLE. Le drapeau du régiment est alors décoré de quatre nouvelles citations (il en avait déjà cinq) ainsi que de la fourragère double, aux couleurs de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre.
A la fin de la guerre 1914-1918, il participe à la pacification du Maroc avec son régiment devenu le 3e Régiment Etranger d’Infanterie.
Paul-Frédéric Rollet est alors promu colonel. En 1925, il prend le commandement du 1er Régiment Etranger à Sidi-Bel-Abbès. Il y restera jusqu’à l'organisation des fêtes du « Centenaire »[1], le 30 avril 1931.
C'est 1er avril 1931 qu'il prend le commandement de l'Inspection de la Légion étrangère, poste créé tout spécialement à son intention.
Après plusieurs années de combat, et de victoires, il prend se retraite le 20 décembre 1935 Il aura effectué 41 années de service militaire, dont 33 ans à la Légion.
Il a consacré les dernières années de sa carrière à l’organisation de la Légion étrangère moderne et à la réalisation d’une œuvre sociale considérable au profit des légionnaires d’active, comme des anciens. Il poursuivra son action sociale après avoir quitté le service actif.
Il meurt à Paris, le 16 avril 1941.
Paul-Frédéric Rollet fut une figure légendaire de la Légion étrangère, grâce à ses qualités de chef, mais aussi de soldat, d'homme de caractère et de cœur. Il est encore surnommé le Père Légion. Ce titre reflètera son implication dans l'organisation des unités, ainsi que l'amour qu'il donnait à ses hommes.









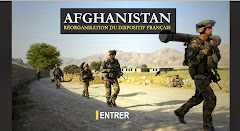


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire